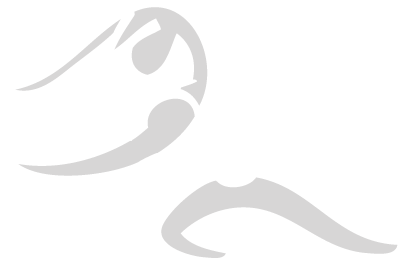Quel est votre métier ?
Je suis une autrice, mais je ne le vois pas comme un métier, plus comme ma façon d’être au monde, de l’attraper. Je me définis comme quelqu’un qui fait face au réel, par rapport à tout ce que je peux en percevoir. Et je le restitue sous différentes modalités ; que ce soit un film documentaire, de l’écrit ou une performance, mais toujours avec une écriture poétique.
Mon statut d’autrice me permet de survivre à la société contemporaine que je trouve brutale.
J’habite en permanence un état de colère, comme si je portais un volcan en bandoulière. Cette colère a pris corps petit à petit, en comprenant comment je suis devenue noire et femme… Alors le fait d’entrer en écriture, de passer par la création, m’a permis de survivre et d’être en paix avec les gens que je côtoye.
Comment vous est venue l’envie d’être autrice ?
Enfant, on a l’intuition de ce que l’on veut devenir, la société (le système scolaire) te pousse à rentrer dans un moule, avec des modèles de réussite et d’échec. On perd un temps fou à ne pas écouter ce que les jeunes ont à dire. Ado, j’avais un carnet d’écriture, où je griffonnais déjà des poèmes et des mots. J’y avais inscrit en vert « je veux être artiste ». A la faveur d’un déménagement, des décennies après, j’ai retrouvé ce carnet et ça m’a beaucoup émue. J’avais oublié ce vœu, mais il a fait son chemin.
Je n’ai jamais eu de plan de carrière. Les choses se sont faites naturellement et un jour je me suis rendue compte que j’étais artiste. Avant, j’ai été attachée de presse, puis journaliste. Mais le journalisme ce sont des faits, une façon de raconter, un moule. Or, je cherche toujours à dire autrement les choses, à raconter ce qu’il y a derrière les faits. Alors j’ai glissé vers la réalisation, et j’ai affirmé cette écriture poétique et politique autour de l’afro-descendance, un thème qui m’a toujours intéressée.
Aujourd’hui, je peux dire que c’est ce qui me nourrit… et qui me pompe aussi.
Comment s’est faite la rencontre avec Kokolampoe ?
En 2014, j’étais au théâtre des Halles pour la création de la pièce « Le temps suspendu de Thuram». Alain Timàr, le metteur en scène, me présente un comédien en me demandant « A qui il te fait penser ? A Kadhafi voyons ! Ça te dirait d’écrire une pièce sur Kadhafi ?»
C’est un peu résumé, mais c’est comme ça que j’ai fait la connaissance de Serge Abatucci, puis d’Ewlyne Guillaume et d’Emilie Blettery.
A la suite de cette rencontre, il y a eu une première résidence d’écriture en 2019 au Centre dramatique Kokolampoe, puis une seconde en Martinique début 2021.
Le texte abouti, a été présenté en lecture publique à Tropiques Atrium, à Fort-de-France en mars, puis au Festival OFF d’Avignon en juillet.
Ecrire « Moi Kadhafi » a fait écho à mes colères ancestrales. Dans cette pièce, je parle depuis moi-même, Afro-descendante, qui a eu pour parent La-honte et La-colère. Je ne m’intéresse pas aux polémiques politiciennes que Kadhafi a pu susciter, mais à sa vision panafricaine, anticolonialiste et anti impérialiste. J’ai beaucoup lu sur la Lybie en amont. Je n’étais pas là pour faire le portrait de l’homme politique, mais bien de la façon dont il a exprimé la frustration des peuples, l’internationale des dominés. Les peuples caraïbéens se retrouvent dans ce combat contre l’hégémonie occidentale.
Que vous apporte l’écriture théâtrale, par rapport à d’autres formes de création ?
Ce que j’aime dans l’écriture théâtrale, c’est que tout se passe au moment présent, tout est vivant. On est entre nous, le plateau et la salle. Je n’ai pas beaucoup d’expérience en écriture théâtrale, mais j’aime cette ambition de créer un nouveau monde et de faire monde avec le public, les comédiens, la régie. C’est un espace de ré-invention, une relation directe. Pour moi, c’est une jubilation que je ne retrouve pas dans l’écriture littéraire ou la réalisation documentaire. On touche à quelque chose de mystérieux qui est en nous. Federico Garcia Lorca disait qu’il fallait bruler les rideaux des théâtres pour confondre ces 2 espaces : scène et plateau. Jeune, j’avais été saisie en lisant ces mots.
J’ai adoré la dernière partie de la résidence de « Moi Kadhafi » pour ça. Avec Serge, Alain Timàr et Alfred Alexandre, qui m’assistait sur la dramaturgie, on était ensemble pour mettre sur pied un nouveau monde.
Vous êtes en Guyane pour tourner un documentaire, pourriez-vous nous en dire quelques mots ?
En fait, je réalise actuellement une série documentaire littéraire de 70 épisodes de 6 minutes. J’ai sélectionné 14 livres antillo-guyanais et, dans chaque livre, j’ai pris 5 extraits qui seront lus par un comédien ; ce qui permettra au téléspectateur de plonger dans la langue et l’univers d’un auteur. L’idée, c’est de documenter chaque extrait avec non seulement des situations de la vie nos territoires, mais également des témoignages de personnes lambda sur chaque thématique abordée. C’est de la poésie documentaire et politique, arrimée au réel.
J’ai également sorti un recueil de 4 longs textes poétiques : « Eclaboussure » qui parle de nos errances, des rivages arrachés, des noms qui nous ont été volés, de nos quêtes de jarres remplies d’or et du pays qui m’habite : la poésie.
En novembre, à Paris, Nantes et Bordeaux, dans le cadre du Mois Kreyol, je vais performer sur scène un de ces textes, dans une forme chorégraphique.
Pour finir, quelle citation aimeriez-vous nous partager ?
Une citation extraite de la pièce de théatre « Noces de sang », de Federico Garcia Lorca :
« Tant qu’on est vivant, on se bat ! ».